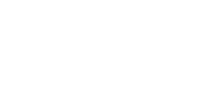Grégoire Darcy
Département Droit - économie - management | Promotion 2020
"Si mon sujet de thèse me semble s'imposer, rétrospectivement, comme une évidence, il est d'abord le fruit de nombreuses rencontres, de hasards et de personnes qui m'ont tendu la main. Étudier la psychologie des normes, levier majeur du changement des comportements individuels et collectifs, me paraissait important pour tenter de contribuer, au moins un peu, aux politiques de transition."
Une approche cognitive des écosystèmes normatifs : essais sur les interactions entre confiance et normes sociales
Institut Jean Nicod, ENS-PSL, EHESS, CNRS
Dir. : Jean-Baptiste André. Co-encadrement : Nicolas Baumard
Résumé : Tous les humains possèdent une psychologie innée des normes sociales, qu'elles soient esthétiques, morales ou juridiques. Leurs systèmes cognitifs génèrent des intuitions fines et flexibles sur ces normes, permettant à chacun de les reconnaître, de les évaluer et de juger de leur importance, de leur nécessité ou de leur nocivité. Par exemple, on peut trouver une norme trop souple, trop vague ou trop sévère. Ces jugements spontanés incluent également des intuitions sur la façon de les articuler, de les modifier, ainsi que sur les contextes où elles sont pertinentes, manquantes ou superflues. Ma thèse portera sur cette cognition des normes et des systèmes de normes, en les considérant comme des technologies culturelles de détection des tricheurs, étudiées à travers le prisme des sciences sociales cognitives. Plus précisément, ma thèse examinera comment certains modules cognitifs intègrent la perception de la fiabilité des autres agents dans l'environnement pour générer des intuitions fines et flexibles sur les normes qui déterminent les caractéristiques des écosystèmes normatifs. En combinant les approches de l'écologie comportementale, de la psychologie expérimentale et de la biologie évolutionnaire avec celles du droit, de l'économie et de l'évaluation des politiques publiques, cette thèse adoptera une perspective interdisciplinaire. Cette thèse par article abordera des questions théoriques telles que : pourquoi aurons-nous besoin de normes rigides si notre cognition morale est flexible ? Pourquoi certaines normes persisteront-elles bien qu'elles soient unanimement considérées comme inefficaces et coûteuses ? Elle traitera également de questions empiriques, par exemple : comment expliquer la disparité de restrictivité et de sévérité des normes entre différents contextes culturels et normatifs ? Pourquoi certaines normes juridiques persisteront-elles spontanément après leur suppression ? Enfin, elle ambitionnera d'avoir des applications potentielles en matière d'analyse de politiques publiques et d'évaluation des systèmes juridiques, en proposant une intégration des mécanismes cognitifs sous-jacents à la perception et à l'application des normes. Par exemple, elle étudiera les sources psychologiques de l'inflation normative et de la demande sociale de normes juridiques.
Ma motivation :
Si mon sujet de thèse me semble s'imposer, rétrospectivement, comme une évidence, il est d'abord le fruit de nombreuses rencontres, de hasards et de personnes qui m'ont tendu la main. Une rencontre avec un champ disciplinaire d'abord : celui des sciences cognitives, c'est-à-dire, pour les définir grossièrement, des sciences étudiant les processus et les produits du binôme cerveau-esprit. Elles représentent en effet l'un des champs scientifiques les plus éloignés de celui de la science du droit, tant en termes d'objets, que de méthodes, de courants, de structurations institutionnelles et de pratiques scientifiques. Cependant, je suis persuadé que c'est justement en raison de la rareté, jusque-là, des interactions entre ces champs que l'interdisciplinarité sera féconde - et passionnante, puisque tant de choses restent à découvrir. Une rencontre ensuite, avec un objet passionnant - à mes yeux tout du moins -, né de questionnements permis par l'interdisciplinarité : c'est en discutant avec des chercheurs d'autres champs qu'on en vient à réaliser les présupposés implicites de nos croyances et des construits spécifiques à nos disciplines - et qu'on conscientise les fondations parfois branlantes sur lesquelles ils reposent. Une rencontre enfin, avec une volonté d'impact et d'utilité. Nous sommes à une période charnière qu'il serait euphémistique de qualifier de défi. Étudier la psychologie des normes, levier majeur du changement des comportements individuels et collectifs, me paraissait important pour tenter de contribuer, au moins un peu, aux politiques de transition.
Mon parcours :
Après une CPGE D1, j'ai intégré le département DEM de l'ENS Rennes. J'ai ainsi obtenu une licence de droit à Rennes I, tout en poursuivant une licence en économie appliquée à l'Université Paris-Saclay. J'ai ensuite tâché de me constituer, en trois ans, un bagage académique pluridisciplinaire dans le cadre du parcours éponyme de l'ENS, en effectuant un Master en Administration Publique (Sciences Po Rennes), un Master de Droit Privé Général (Université Panthéon-Sorbonne,) et un Master de Sciences Cognitives (ENS-PSL, EHESS, Université Paris-Cité). À ce titre, j'ai une triple dette envers l'ENS. D'abord, pour l'exposition à l'interdisciplinarité, qui a été fondamentale dans la construction de mon projet de thèse. Ensuite, pour la possibilité de construire un parcours vraiment sur-mesure : où ailleurs peut-on étudier, au même semestre, la programmation, l'anthropologie juridique et la neurobiologie ? Enfin, pour le cadre, puisqu'il fut le lieu de rencontres tant intellectuelles qu'amicales qui ont autant façonné mon projet de thèse que mon identité.
- Thématique(s)
- Débouchés, Recherche - Valorisation
Mise à jour le 17 octobre 2025