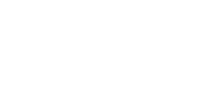- Alexis Fradetal Professeur stagiaire | Lycée polyvalent de Cachan
- Antonin Weiss Cadre de direction Banque de France
- Colin Gatouillat Doctorant en sciences du mouvement humain | Aix-Marseille Université - Institut des Sciences du Mouvement Étienne-Jules Marey
- Édouard Dossetto IPEF, doctorant | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Fanny Lagarde Rédactrice Justice et Affaires intérieures à la Direction de l’Union européenne
- Léa Gottsmann Doctorante en Sciences du sport | Université Clermont Auvergne - Labotatoire ACTé
- Loïc Bréhin Doctorant en droit privé à l’Université Panthéon-Assas
- Marine Fouquet PRAG | IUT Sénart Fontainebleau – UPEC
- Théo Perrin Agrégé d’EPS, doctorant en STAPS | Université Rennes 2 - Laboratoire M2S
Accès directs